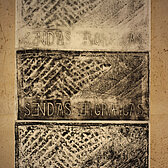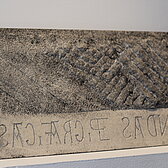Matière
Depuis son apparition, l’écriture rencontre des matières diverses : le papyrus, la peau du parchemin, la terre cuite, le bois, le plomb, le verre, la pierre. Il y aurait finalement toujours eu « matières à écrire », autorisant la production d’une diversité d’objets et donc d’espaces pour l’écriture.
Les monnaies, les sceaux, les ostraka, les pots, les tapisseries ou les bagues peuvent être rangés dans le champ de l’épigraphie, comme tout autre objet écrit présentant une densité matérielle et un certain volume. Enfin, toute évocation figurative d’une matérialité épigraphique, même sur la page du manuscrit, établit une nouvelle inscription.
La rencontre entre l’écriture et la matière est le fruit d’un processus technique et de gestes adaptés. La matière épigraphique est toujours manipulée – gravée, incisée, sculptée, fragmentée, collée, tissée – et la part du geste technique, artisanal, artistique, qui donne vie et verbe à cette matière y laisse son empreinte.
Dans ce contexte, on peut se demander quelles sont les incidences d’un matériau sur l’écriture : quelle est la part de la contrainte technique dans le dessin des formes ? la nature de la matière confère-t-elle une valeur particulière au message qu’elle porte ou compose ? l’écriture est-elle le fruit d’une soustraction de matière ou au contraire d’un ajout, à moins qu’elle ne soit empreinte ou encore entrelacement ?
À l’évidence, et plus que d’autres, l’objet épigraphique oblige à observer le matériau autrement que comme un composant inerte : il n’est pas seulement un fond ou un support. Il participe aussi pleinement à la dimension esthétique de l’inscription et les œuvres contemporaines invitent à porter plus d’attention à la beauté engagée par la matière même dans l’objet épigraphique.
Si la matérialité de l’inscription est l’une des conditions de préservation de l’écrit, il n’en demeure pas moins que la matière s’abîme, vieillit et le message parfois se perd. Lieu de l’écriture et de sa disparition, la matière épigraphique joue avec le temps.